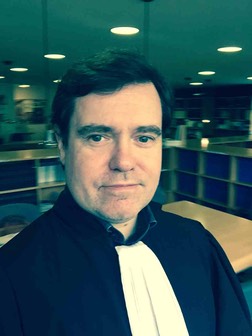Successions
Successions 1. Pièges de l'assignation en partage d'indivision.
Les pièges de l'assignation en partage d'indivision : quelques éclaircissements jurisprudentiels.
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste
Docteur en droit privé
On savait que l'action en partage était un parcours semé d'embuches, qu'il fallait respecter un stricte formalisme procédural. Il convenait notament faire une tentative amiable avant d'engager la procédure judiciaire, ce qui ralentit le déclenchement de la procédure et peut entraîner par défaut, un rejet de l'assignation. L'assignation devait également contenir un descriptif sommaire des biens à partager.
Autant de contraintes qui peuvent rendre la tâche des conseils compliquée...
Pour autant les héritiers n'ont parfois pas le choix, pour sortir de l'impasse d'une indivision qui ne satisfait personne et qui devient ingérable sur le long terme.
De récentes décisions viennent de rendre un peu plus facile la mise en oeuvre procédurale de cette action devant le tribunal de grande instance.
I - ASSOUPLISSEMENT POUR LE CREANCIER POURSUIVANT DEMANDEUR DU PARTAGE
L’action oblique dispense des formalités 1360 CPC.
Référence : Cour d’appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 22 janv. 2014, RG N° 13/04148.
Le créancier personnel de l’indivisaire ne dispose, sur le fondement de l’art 815-17, alinéa 3, du Code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, de sorte que les dispositions de l’art. 1360 du Code de procédure civile (CPC), qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage.
S'il pouvait y avait un doute jusqu'à présent, la solution vient d’être confirmée par la cour de cassation qui clot le débat :
«Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil» (Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.272).
II - ASSOUPLISSEMENT POUR LES HÉRITIERS DEMANDEURS DU PARTAGE
La question du descriptif sommaire des biens ou de la tentative amiable a été l'objet de moyens dilatoires visant à demander l'irrecebailité de l'assignation en partage.
La cour d'appel d'Aix en Provence semble assouplir cette exigence en lui donnant une toute autre portée. La solution dégagée est d'autant plus importante qu'elle a été validée par la cour de cassation :
« L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'art. 1360 c. pr. civ. est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; [...] cette omission est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'art. 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; [...] il s'en déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation ;
[...] ayant retenu exactement que l'assignation n'avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et estimé souverainement, par motif adopté, que cet acte en contenait un descriptif sommaire, la cour d'appel a procédé à la recherche que la quatrième branche lui reproche d'avoir omise ».
En conclusion, le descriptif sommaire des biens peut être régularisé en cours de procédure (tant que la clôture n'a pas été prononcée) car il s'agit d'une fin de non recevoir et non d'un moyen d'irrecevabilité, et il n'est plus nécessaire que l'assignation contienne ces mentions à peine de nullité.
Successions 2. Vente du bien en indivision.
Le bien immobilier en indivision peut-il être vendu par un seul des héritiers en cas de mésentente ?
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé
La réponse est affirmative mais sous conditions.
Selon l’article 815-5 du code civil qui définit les mesures d'intérêt commun :
«Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.»
Reste à définir ce qu'est un acte dont l'absence met en péril l'intérêt commun. L'acte autorisé par le juge peut être une aliénation, puisque le texte ne fait pas de distinction entre actes d'administration et actes de disposition. Les illustrations jurisprudentielles de la règle sont d'ailleurs relatives à de tels actes.
Dans un cas, la vente a été autorisée parce qu'elle pouvait être passée dans des circonstances exceptionnellement avantageuses (Civ. 1re, 29 nov. 1988, n° 86-14.496 , Bull. civ. I, n° 340 ; JCP 1989. II. 21364, note Testu ; RTD civ. 1989. 609, note Patarin ; RTD civ. 1990. 110, note Zenati).
Selon l’article 815-6 du code civil qui définit les mesures d'urgence :
«Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun (...)»
Il existe en tout cas des conditions à l'intervention du juge : la mesure doit être commandée par l'urgence, et elle doit être justifiée par l'intérêt commun des indivisaires. Ce sont deux conditions distinctes.
Les deux derniers paragraphes de l'article 815-6, ainsi que l'article 815-7 du Code civil, donnent quelques exemples de mesures que le juge peut ordonner. Il s'agit d'une liste indicative, comme le révèle l'adverbe « notamment ».
L’autorisation de vendre un bien indivis peut donc faire également partie des mesures autorisées par le juge.
Successions 3. Assurance-vie et comptes bancaires après décès.
Le sort des comptes bancaires et des polices assurances-vie.
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste Docteur en droit privé
Lorsqu'une succession est ouverte par le notaire de la famille, deux difficultés peuvent se présenter :
- il n'est pas toujours facile pour le notaire de connaître l'inventaire et le solde des comptes ainsi que les polices d'assurance vie du défunt;
- une personne de la famille a pu utiliser sa procuration pour retirer de l'argent sur le compte à l'insu des autres héritiers entre le moment du décès et le moment de l'arrêté des comptes par la banque.
1°/ Sur l'identification des comptes bancaires et assurances vie
L'absence de coopération voir la franche hostilité des héritiers, peut rendre cette tâche extrêmement ingrate. Il n'est pas rare que certaines succession au bout de plusieurs années ne soit pas liquidées, alors qu'il existe des fonds importants bloqués sur les comptes du défunt.
Fort heureusement, le législateur vient d'apporter un précieux secours aux héritiers. Par une loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, il a été prévu dans l'article 8 que le notaire chargé de la succession puisse obtenir sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés. Cela afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. En outre, les ayant droit pourront également obtenir sur leur demande les mêmes informations.
Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
2°/ Sur les retraits effectués par une personne ayant procuration sur le compte
Il n'y a pas de présomption de don manuel en pareil cas et le rapport à la succession ainsi la restitution de ces fonds peuvent être exigés.
La cour de cassation a ainsi jugé :
"Jeannine X veuve Y est décédée le 12 févr. 2005, laissant pour lui succéder M. Jacques Z, son fils unique, et M. Laurent Z, son petit-fils, institué légataire universel par testament olographe du 30 juin 2001 ; M. Laurent Z a reçu des sommes d'argent de sa grand-mère dont M. Jacques Z a sollicité la restitution à la succession.
M. Laurent Z a fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à la succession de Jeannine Y la somme de 50.033,26 euro, alors, selon lui et notamment que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
Mais, d'abord, il résulte des énonciations de l'arrêt que la somme litigieuse n'a pas été remise par Jeanne X à M. Laurent Z, mais qu'elle a été perçue par ce dernier au moyen de la procuration qu'il détenait sur les comptes bancaires de la défunte ; dès lors, M. Laurent Z, détenteur précaire, ne pouvant se prévaloir des règles de la possession, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'établissait pas l'intention libérale de sa grand-mère.
Ensuite, la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'une libéralité, n'a pas condamné M. Laurent Z à restituer la somme litigieuse provenant de rachats partiels du contrat d'assurance-vie au motif qu'elle ne pouvait constituer un capital-décès échappant aux règles de la réduction et du rapport."
Cass. Civ. 1re, 13 févr. 2013 (N° de pourvoi : 12-13.538), rejet, non publié