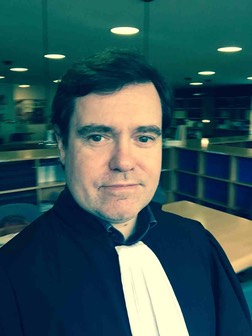Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement et droit Communautaire.
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège les droits fondamentaux : le droit à un procès équitable, le droit à l’intégrité physique, le droit à une vie familiale etc.
Il n’était pas évident a priori d’en faire un usage approfondi dans le domaine de l’urbanisme.
Pourtant les requérants ont vite compris son utilité dans ce domaine, parfois avec un indéniable succès, parfois en s’exposant à des échecs cuisants.
Elle contient en effet plusieurs articles qui ont trouvé application en droit de l’urbanisme tels que :
"Toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens (al. 1er, 1re phrase).
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international public (al. 1er, 2e phrase).
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes (al. 2). »
Rappelons que ces disposition de la CEDH sont directement applicables devant les tribunaux nationaux, et ce, avant même de saisir la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui n’est pas un quatrième degré de juridiction.
1°/ Recours à la CEDH en vue d’empêcher la démolition d’un immeuble qui est le foyer familial
Lorsqu’un tribunal correctionnel constate l’infraction consistant à construire une maison sans permis de construire, il est en droit d’en ordonner la démolition. La mesure est parfaitement légale car elle prévue par le code de l’urbanisme.
Toutefois, une telle mesure peut paraître excessive compte tenu de la situation personnelle du prévenu.
La Cour de Cassation a ainsi annulé l’arrêt de la Cour d’Appel qui ne justifiait pas, au regard de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 1193 du Code de procédure pénale, avoir répondu aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La mesure s’appliquait en effet à son domicile où il vivait avec sa femme et ses deux enfants. Il ne disposait pas d’autre lieu de résidence et ce en dépit de demande de relogement :
« Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu'elle viserait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ». (Cass. criim. 31 janvier 2017 n° 16-82945).
Cette décision n’est guère surprenante. En effet, par un arrêt du 17 décembre 2015, la Cour de cassation avait déjà fait application de la jurisprudence Winterstein c/ France de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et admis que le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), pouvait faire obstacle aux règles d’urbanisme.
2°/ Recours à la CEDH en vue d’empêcher un projet immobilier de se réaliser
2.1. Invocation d’une liberté fondamentale contre les règles d’urbanisme
Un projet immobilier peut être interdit au motif qu’il n’est pas conforme à une norme esthétique fixée par le PLU d’une commune.
La question a été posée à la CEDH par un administrateur qui avait réalisé « sans autorisation sur les façades de l’immeuble dit “Domaine de la Source“ [ou “Demeure du Chaos“, à Saint-Romain au Mont d’Or – Département du Rhône], […] des peintures, inscriptions et dessins de couleur rouge ou noire et […] des insertions de blocs de pierre noire », ceci alors que l’immeuble en question « était situé en état de co-visibilité avec une église et un manoir, tous deux inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques »
La CEDH a confirmé que les condamnations pénales et civiles infligées – notamment – à un artiste plasticien pour « non-respect des règles édictées en matière de droit de l’urbanisme » n’emportaient par violation par la France de sa liberté d’expression (Art. 10).
En cas de conflit entre le droit d’expression et le droit de l’urbanisme, c’est ce dernier qui semble primer.
Dans une autre affaire, le requérant avait invoqué l’application de la CEDH pour critiquer l’interdiction de reconstruire à l’identique une maison détruite par un incendie mais édifiée illégalement sans permis de construire. Il estimait que la décision de refus du Maire fondée sur l’article L 111-3 du code de l’urbanisme méconnaissait les dispositions protectrices de la CEDH.
Une juridiction administrative a estimé que la décision de refus du Maire bien que très contraignante en limitant les droits de construire, respectait un but d’intérêt général et ne méconnaissait pas les dispositions de la Convention (CAA Versailles, 28 septembre 2017, n° 16 VE00379).
2.2. Tentatives d’annulation d’un projet d’intérêt général en invoquant les droits fondamentaux et la protection des biens
Le Conseil d’Etat a jugé qu’un arrêté préfectoral portant déclaration d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121-9 du Code de l’Urbanisme ne portait pas, en lui-même, une atteinte aux droits et aux respects des biens (Voir CE 4 juin 2012 SARL du Parc d’Activité de Blotzheim et SCI Haselaecker, req. n° 340213, Lebon) dans les termes suivants :
« (…) un arrêté portant déclaration d’un projet d’intérêt général s’impose aux document d’urbanisme des personnes publiques auxquelles il est notifié, qu’en revanche, ce n’est que par la modification de ces documents qu’il a des effets juridiques sur l’utilisation des sols, et que par suite, il n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme ; qu’il suit de là que l’arrêté du 28 novembre 2008 ne porte pas, en lui-même, atteinte au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme ».
L’arrêté portant déclaration d’un projet d’intérêt général s'impose aux documents d'urbanisme des personnes publiques auxquelles il est notifié. Mais ce n’est que par la modification de ces derniers documents que le projet d’intérêt général a des effets juridiques sur l’utilisation des sols. Il n’est donc pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme.
Force est de rappeler que le conseil constitutionnel avait déjà donné un coup de pouce en ce sens en énonçant le 28 janvier 2011, que les dispositions de l’article L. 121-9 du Code de l’Urbanisme, ne portaient pas atteinte principes fondamentaux du droit de propriété, lequel est garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Décision n° 2010-95 QPC).
3°/ Recours à la CEDH en vue d’être indemnisé en contrepartie d’une sujétion d’urbanisme
Certains administrés ont été également tentés de saisir la CEDH compte tenu de sujétions particulières imposées en raison de leur proximité du littoral.
L’article L. 160-5 du code de l’urbanisme dispose à ce sujet :
« N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées (...) concernant, notamment, (...) l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies (...).
Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d’occupation des sols rendu public ou du plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. »
Dans un arrêt du 3 juillet 1998, dont la solution a été confirmée par la suite (Bitouzet, Recueil Lebon p. 228), le Conseil d’État a interprété cet article à la lumière de l’article 1 du Protocole n° 1 de la CEDH et il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un principe général et absolu, en droit français, de non‑indemnisation des servitudes d’urbanisme
Autrement dit, l’exclusion de l’indemnité n’étant pas systématique mais seulement conditionnée par certains critères, le dispositif serait équitable.
On pouvait toutefois en douter, tant les indemnisations sont rares notamment en ce qui concerne l’application de la loi littorale.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient toutefois de juger, dans son arrêt « Malfatto et Mieille c/ France » rendu le 6 octobre 2016 que le droit français bien que n’indemnisant pas – sauf cas exceptionnel – les servitudes d’urbanisme, respectait bien le juste équilibre entre intérêt général et droit des particuliers :
"La Cour observe que, tel qu’il a été interprété par le Conseil d’État, l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme permet au propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude de prétendre à une indemnisation devant la juridiction administrative « dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi » . La Cour estime qu’il s’agit là d’un système qui permet de mettre en balance les intérêts de l’intéressé et ceux de la communauté ».
4°/ Recours à la CEDH pour critiquer les procédures internes
4.1. Critique des procédures lorsqu’elles restreignent le droit d’agir en justice contre les projets d’urbanisme
Les règles de notification des recours gracieux et contentieux sont particulièrement sévères en droit interne.
Si le recours n’est pas transmis au pétitionnaire par lettre recommandée, l’accès au juge n’est plus possible, sa requête est irrecevable et aucune régularisation n’est possible.
Quid du droit d’accès au juge qui est garanti par la CEDH ?
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux saisie de cette question a répondu par un arrêt du 31 août 2006 et indiqué que le mécanisme de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme n’était pas incompatible avec l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par le considérant suivant :
« Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.4117 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'application de ces dispositions à la condition qu'il soit fait mention de celles-ci dans l'arrêté accordant un permis de construire ; que l'absence de mention de ces dispositions dans un tel arrêté n'a pas pour effet de porter atteinte au droit qu'ont les justiciables à ce que leur cause soit entendue par un tribunal conformément aux stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
4.2. Critique des procédures internes lorsqu’elles constituent une atteinte à la protection du domicile et au respect de la vie privée
Certains requérants poursuivis pour des infractions au droit de l’urbanisme peuvent également être tentés d’attaquer les procédures sur le terrain de la CEDH.
Voir par exemple, la Requête no 66554/14 Simon HALABI contre la France, introduite le 26 septembre 2014 :
"Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’atteinte portée, au cours de la visite effectuée par les agents de l’urbanisme le 19 mars 2009, à son droit au respect de son domicile. Il fait valoir que la législation nationale ne lui a pas offert de garantie contre l’arbitraire avant ou après la visite domiciliaire, alors qu’il n’avait pas consenti à la visite des lieux. » Voy. CEDH, 7 avr. 2017, n° 66554/14.