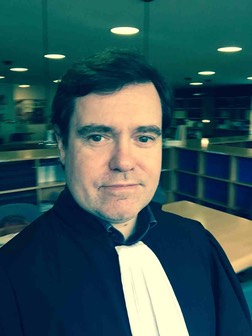Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Comparaison n’est pas (toujours) raison. Dans deux affaires apparemment très proches, deux juridictions appartenant à deux ordres étatiques différents ont apporté une réponse (en apparence) diamétralement opposée à un problème similaire : l’extension d’un aéroport.
1° Deux décisions en apparence opposées :
En cette année 2020, deux extensions d’aéroports ont été soumises au contrôle du juge.
L’un est situé à Nice en France et l’autre en Angleterre (aéroport d’Heathrow).
1.1. Saisi en référé, le juge administratif de Nice a débouté les requérants de leur demande de suspension de l’arrêté du préfet du 13 janvier 2020 accordant un permis de construire pour l’extension du terminal T2 de l’aéroport Nice Côte d’Azur.
Il a estimé que "la légalité du permis de construire accordé le 13 janvier 2020 par le préfet des Alpes-Maritimes à la société Aéroports de la Côte d’Azur pour l’extension du terminal T2 de l’aéroport de Nice doit s’apprécier au regard des seules incidences directes ou indirectes que les nouveaux bâtiments sont par eux-mêmes susceptibles d’emporter sur leur environnement, tant au cours des travaux de construction que dans leur usage, une fois achevés. Aucun élément ne permet de penser, en l’état de l’instruction, que la construction ou le fonctionnement de l’extension projetée aurait par elle-même, ou par effets induits, des incidences notables sur le réchauffement climatique, la biodiversité ou la santé publique ».
Il a jugé également qu’aucun des moyens soulevés par ailleurs par les requérants « t tenant notamment à des risques pour la sécurité publique ainsi qu’à des atteintes au littoral ou à des zones naturelles protégées ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté » (TA DE NICE : 28/02/2020).
1.2. La cour d’appel d’Angleterre a en revanche jugé illégal le projet de construction d’une troisième piste, faute de prise en compte des engagements climatiques du Royaume-Uni par une décision historique en date du 27 février 2020 donc la veille de la décision rendue par la juridiction française…
La motivation de ce rejet est d’autant plus intéressante qu’elle fait appel au droit de l’environnement et fait référence aux objectifs climatiques : la justice a stigmatisé l’absence de prise en compte, dans l’élaboration du projet, des engagements climatiques du Royaume-Uni pris dans le cadre de l’accord de Paris de 2015 visant à contenir le réchauffement.
Rappelons que c’est le maire de Londres qui était à l’initiative de cette procédure et qu’il a donc obtenu satisfaction.
Mais le juge statué davantage sur la forme que sur le fond, la cour d’appel s’est prononcée sur la forme et non sur le fond :
« L’accord de Paris aurait dû être pris en compte par le secrétaire d’Etat [aux transports] dans la préparation de la déclaration de politique nationale soutenant ce projet, et une explication aurait dû être donnée sur la façon dont il a été pris en compte, ce qui n’a pas été le cas ».
Autrement dit, le dossier aurait pu passer si l’impact de l’extension avait été évalué sur le plan environnemental ce qui n’avait pas été le cas.
2° Deux décisions qui ne sont pas si éloignées l’une de l’autre :
Le juge des référés Niçois n’a pas tranché le fond du dossier, mais a seulement estimé que rien dans le dossier présenté ne permettait de mettre en doute la régularité de la procédure. Tandis que pour le tribunal anglais, l’évidence résultait de l’absence manifeste d’évaluation environnementale du projet. Nous ne sommes donc pas sur un même plan, et il serait donc simpliste d’opposer radicalement les deux décisions. Ce d’autant que le projet d’extension de l’aéroport de Nice faisait l’objet de contre mesures à caractère environnemental (même si on peut discuter de leur efficacité réelle). L’affaire Niçoise n’est d’ailleurs pas finie, le juge du fond ayant été également saisi.
3°/ Quelles « pistes » à suivre pour obtenir l’annulation d’un projet d’extension ?
On le sait notamment depuis l’affaire de l’aéroport de Nantes- Atlantiques (Notre Dame des Landes), le juge administratif n’est pas souvent l’allié des opposants aux projets d’aéroports… Il a souvent rejeté les recours pourtant bien argumenté (Cour administrative d’appel de de Nantes - 2ème Chambre 7 février 2014 / n° 13NT00529).
Pour une simple extension d’aéroport et non une création, le challenge à relever pour les opposants est encore plus difficile à relever car le juge se refuse d’adopter une analyse globale des nuisances, et ne tient compte que des conséquences stricto sensu de l’extension.
Ainsi, quid par exemple des incidences de l’extension sur l’augmentation du trafic des avions ?
Si l’appréciation du trafic n’est pas intégrée dans le bilan environnemental du projet d’extension, il est clair qu’il devient difficile de le contester sur ce terrain.
On peut toutefois s’intéresser à différentes aspects connexes, comme le financement (s’il existe un financement européen, il devrait logiquement conforme aux objectifs de développement durable de l’Union européenne) et également aux rares décisions dissidentes qui ont annulé des DUP alors que la grande majorité des décisions les valident quand il s’agit de projets d’intérêt national.
3.1. Pour le financement, une décision pourrait faire réfléchir les requérants : saisi par plusieurs associations et collectivités territoriales, le Conseil d’État a annulé le décret déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Poitiers à Limoges. Ce dernier a constaté que l’analyse des conditions de financement envisagées, incluse dans l’évaluation économique et sociale du projet, ne contenait aucune information précise et que cela avait nui à l’information complète de la population (Voir CE, 14 avril 2016, Fédération nationale des associations des usagers des transports et autres, nos 387475 et autres, Rec. Lebon).
3.2. Par ailleurs, rappelons qu’une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. De même, les insuffisances de l’évaluation économique et sociale dans le dossier soumis à enquête publique nuisent à l’information complète de la population et peuvent exercer une influence sur la décision d’adoption du décret de déclaration d’utilité publique (Voir CE, n°387475 du 15 avril 2016, LGV Poitiers-Limoges).
Un bilan négatif de l’opération projetée, en tenant compte de l’ensemble des intérêts publics et privés, conduira les pouvoirs publics à écarter le caractère d’utilité publique.
Dans une première décision concernant l’autoroute Transchablaisienne (Annemasse-Thonon), le Conseil d’Etat a considéré que l’importance du coût financier du tronçon contesté au regard du trafic espéré devait être considérée comme excédant l’intérêt de l’opération (CE, 28 mars 1997, « Association contre le projet d’autoroute transchablaisienne et autres », p. 120).
Dans une autre décision plus récente, le Conseil d’Etat a reconnu l’absence d’utilité publique d’une bretelle autoroutière, CE 22 oct. 2003, Assoc. SOS Rivière-Environnement, req. n°s 231953).
Le Conseil d’Etat a également annulé une DUP après avoir constaté les atteintes portées à l’environnement par le projet de création d’un barrage en amont du bassin Marennes-Oléron, ce qui en justifie l’annulation (CE 22 octobre 2003, annulation d’un décret, en date du 29 janvier 2001, déclarant d’utilité publique et d’intérêt général le projet de création du barrage de la Trézence dans le département de la Charente-Maritime).
Dans une autre affaire encore plus récente, qui concernait l’extension du réseau de tramway à Strasbourg, le tribunal administratif avait annulé la DUP d’extension et la réalisation des accompagnements en raison de l’insuffisance de l’analyse de la question de la circulation automobile pour l’opération de démolition-reconstruction d’un pont et la création d’une nouvelle liaison routière. Il avait également stigmatisé une analyse insuffisante des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement (Tribunal administratif de Strasbourg, 19 octobre 2004, Association des résidents du secteur Orbey-Kurgarten et Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé). Il est intéressant de constater que dans cette affaire, le tribunal s’était intéressé aux effets indirects de l’extension du réseau sur le réseau routier et sa réorganisation. Et qu’il avait considéré que l’étude d’impact était de ce point de vue insuffisante.
En 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule l’arrêté du préfet du Val d’Oise autorisant la création de la ZAC dite du « Triangle de Gonesse ». Au regard de l’importance de l’impact potentiel de ce projet sur l’environnement, et compte tenu notamment de la suppression de 280 hectares de terres agricoles, cette juridiction a considéré que tel était le cas en l’espèce, ce qui a justifié l’annulation prononcée. Le tribunal a également relevé que l’étude était insuffisante s’agissant de l’incidence du projet sur la qualité de l’air, compte tenu notamment des émissions de CO2 induites par les déplacements de touristes, eu égard à la création d’Europacity. Il apparait donc que les considérations environnementales sur la qualité de l’air font désormais partie du raisonnement du juge (Voir TA Cergy Pontoise N°1610910, 6 mars 2018).
Enfin, en 2019, la DUP du Préfet des AM en date du 7 juillet 2014 prise pour l’extension de la pénétrante CANNES-GRASSE a été annulée par la CAA de Marseille, après une première validation du tribunal administratif de Nice en 2017. La Cour a en effet considéré que « les propos du Commissaire Enquêteur « s’analysent comme un parti pris initial favorable au projet » et qu’ils ont donc « entaché la procédure d’un vice qui a privé le public d’une garantie » (CAA Marseille, 8 juillet 2019).
On observera que pour le projet de métro du Grand Paris, le juge administratif a au contraire validé la DUP et le projet considérant que toutes les précautions avaient été prises pour limiter l’impact sur l’environnement (CE 9 juillet 2018, N° 410917).
Il doit être noté que le Conseil d’Etat se montre très permissif lorsqu’il affirme dans son arrêt du 5 décembre 2018 que si l’opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) doit être compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme, cette compatibilité doit être contrôlée en prenant en compte le caractère programmatique de l’opération (Voir CE, 5 décembre 2018, n°412632, Mentionné au recueil Lebon). Autrement dit, on ne peut pas se servir de l’absence de disposition dans le PLU pour invalider le projet.
3.3. Ajoutons enfin que si le projet litigieux nécessite des expropriations, une disposition importante devra être utilement mise en oeuvre par les personnes expropriées. Il s’agit de l’article 4 de la loi du 2 février 1995 codifié à l’article L. 12-5 alinéa 2 du code de l’expropriation qui dispose que :
« En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ».
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.